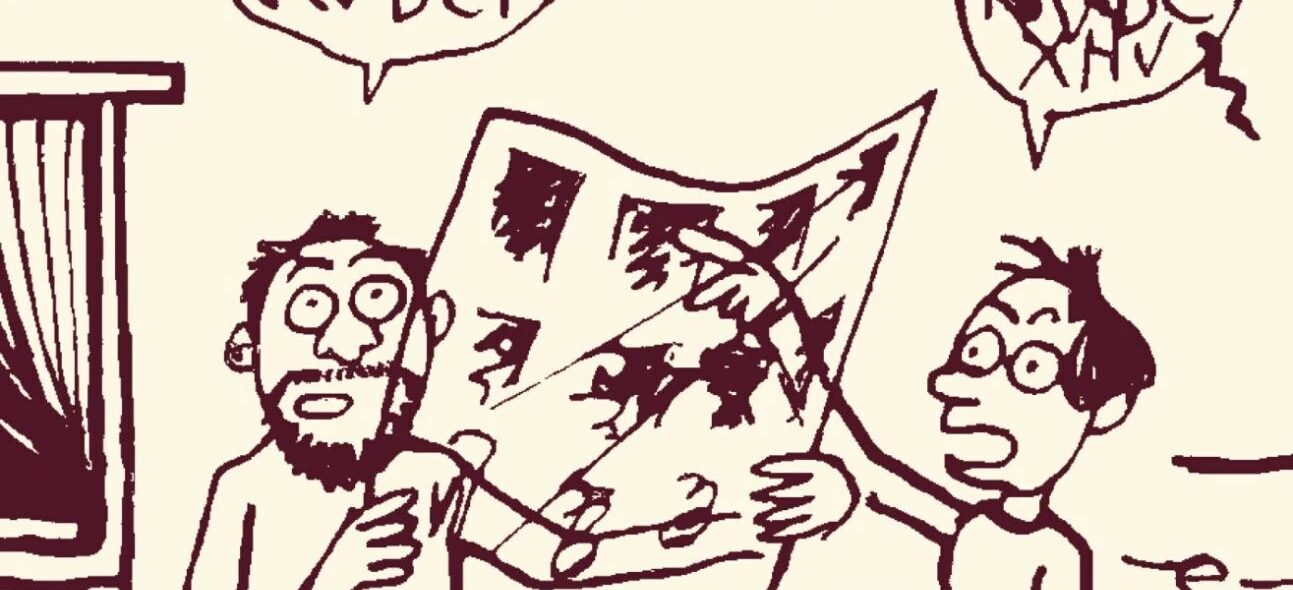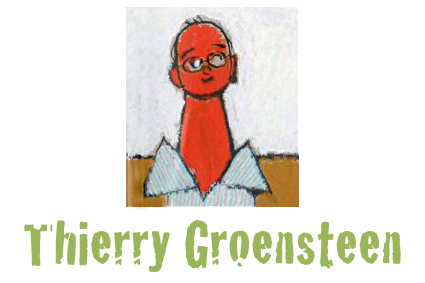L’aventure de la bande dessinée dite indépendante ou alternative a fait l’objet de plusieurs études détaillées ces dernières années. De nouvelles qualifications lui ont été attribuées : celle de dissidence (cf. C. Dony, T. Habrand et G. Meeters, dir., La Bande dessinée en dissidence. Alternative, indépendance, auto-édition, Presses universitaires de Liège, 2014) et celle de contrebande dans le récent ouvrage de Morvandiau déjà discuté ici [https://www.thierry-groensteen.fr/index.php/2023/12/26/morvandiau-radio…tion-alternative/].
C’est à présent le tour de Benjamin Caraco de nous proposer Une Histoire de l’Association, sous-titrée Bande dessinée d’auteurs et légitimité culturelle. Publié aux Presses universitaires François Rabelais dans la collection « Iconotextes », l’ouvrage est issu de sa thèse (soutenue en 2017), comme l’était également celui de Morvandiau. Docteur en histoire, conservateur des bibliothèques et co-rédacteur en chef du site Nonfiction.fr, l’auteur livre un travail très solide, sur lequel pourront s’appuyer les futurs historiens de la bande dessinée. L’un de ses atouts est d’avoir utilisé des sources orales, en conduisant quelque 32 entretiens avec des auteurs de l’Association, des salariés et deux proches (dont votre serviteur).
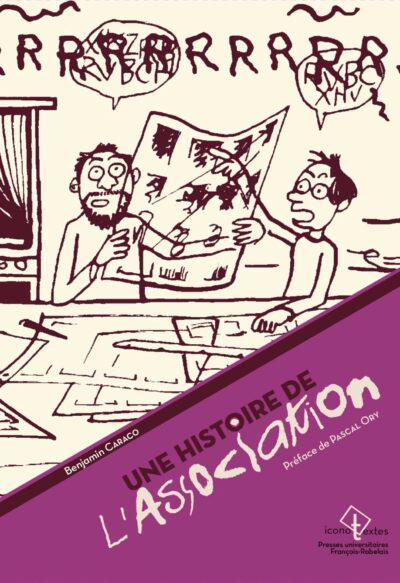
Découpé en plusieurs parties, le livre aborde notamment la constitution du collectif qui fondera l’Association, son inscription dans l’histoire de la BD, l’organisation et le fonctionnement de la structure ainsi que les conflits qui l’ont secouée. Il comprend également une analyse du catalogue (en référence aux questions de genre et de collection), soulignant la grande fidélité de l’Association à ses auteurs.
J’ai été moins convaincu par le chapitre portant sur le discours qui a accompagné les œuvres, presque entièrement produit par Jean-Christophe Menu. Non que les analyses de Caraco ne soient pas pertinentes, mais parce que, de ce discours, il ne produit aucun exemple, pas la moindre citation, ce qui confère à son propos une certaine sécheresse et surtout un certain niveau d’abstraction.
Il est regrettable aussi que l’étude ne porte, comme ne l’indiquent ni son titre ni le texte en quatrième de couverture, que sur les années 1990 à 2015 (la thèse, elle, s’arrêtait à 2011). Il nous manque une décennie complète, alors qu’il serait évidemment du plus haut intérêt de voir comment un certain nombre des questionnements qu’elle soulève ont évolué – par exemple la question de la direction collégiale, celles de l’ouverture aux femmes, de la volonté de conserver « vivants » (c’est-à-dire disponibles) le plus grand nombre de titres, et, plus encore, de la « banalisation » à laquelle concourent à la fois le passage du temps, la récupération d’un certain nombre d’innovations par les grands éditeurs, la multiplication des acteurs sur le marché de l’édition et, parmi les nouveaux entrants, de quelques maisons au positionnement plus radical.
Pour terminer, j’exprimerai mes réserves sur un point qui n’est pas seulement de terminologie. Dans le compte-rendu que Caraco a lui-même consacré, sur son site, à l’ouvrage de Morvandiau, il écrivait que « l’utilisation du terme ”contrebande” peut être questionnée ». J’en dirais autant de celui d’avant-garde, appliqué à l’Association non seulement par Caraco mais aussi par son préfacier, Pascal Ory. Ce dernier écrit que l’Association a produit « rien de moins qu’une école artistique, appelée à jouer pendant une vingtaine d’années un rôle, conscient et organisé, d’avant-garde. » Il situe cette aventure éditoriale « dans la continuité des écoles radicales du XXe siècle, principalement le surréalisme et le situationnisme », dont l’Association a notamment repris à son compte « l’intense tropisme polémique ».
Ce faisant, Ory ratifie la revendication formulée par Menu soi-même. Dans son essai Plate-Bandes (2005), celui-ci confessait l’ambition de faire de la maison d’édition L’Association l’incarnation même de l’avant-garde. Et précisait (p. 12) que « L’Association fut, parmi d’autres choses, une tentative pour extrapoler à la bande dessinée quelques principes de base du surréalisme » : récits de rêve, expériences collectives, cadavre exquis, etc. Caraco relève (p. 17) que la presse a quelquefois comparé l’Association aux éditions de Minuit – comme elle avait auparavant, je le rappelle, érigé Casterman en Gallimard de la bande dessinée et la collection « Copyright » des éditions Futuropolis en « Pléiade » du neuvième art.
Au sommaire du premier numéro de L’Éprouvette, la revue théorique de l’Association, figurait un dossier sur le thème « Bande dessinée et avant-garde », avec des contributions de Pacôme Thiellement, Christian Rosset et J.-C. Menu. Le premier cité écrivait : « L’ennemi de l’avant-garde, c’est le monde marchand et sa fossilisation dans le succédané ». Tel fut aussi, indubitablement, l’ennemi de l’Association, mais cela suffit-il à en faire une école d’avant-garde ? De même, quand Menu écrivait aux collaborateurs pressentis de la revue, avant qu’elle n’existât, « Tout discours pertinent sur la bande dessinée aura sa place dans la revue, ce qui en fait automatiquement une revue d’avant-garde » (phrase citée par Rosset), est-il besoin de souligner la dimension excessive et pour tout dire extravagante de cette affirmation (dont, quand j’étais moi-même aux manettes des Cahiers de la bande dessinée, j’aurais pu signer la première partie, mais en aucun cas la seconde) ?
Rosset rappelle cette évidence qu’« il n’y a plus d’avant-garde depuis un bon quart de siècle » (on est alors en 2006). La bande dessinée n’a jamais vraiment connu d’avant-garde constituée en mouvement, mais on pourrait avancer qu’Herriman – et plus près de nous Crepax, Bazooka, Vaughn-James, Raw, Valvoline (pour ne citer que quelques jalons)… – s’inscrivirent dans une lignée d’alternative à la bande dessinée mainstream. La BD en dissidence a son histoire propre. Et, comme je l’ai écrit dans Le Bouquin de la bande dessinée (article « Avant-garde », auquel je renvoie pour de plus amples développements), les auteurs de l’Association eux-mêmes sont tous « en dette plus ou moins avouée vis-à-vis de tel(s) ou tel(s) prédécesseur(s). Pour ne parler que de Menu lui-même, son petit théâtre mythologique à base de pyramides, de dinosaures, de rochers-coquilles et de « mune » s’inscrit sciemment dans la postérité d’Herriman, déjà relayée, dans l’espace francophone, par F’Murr (Le Génie des Alpages) et Mandryka (Le Concombre masqué). »
En résumé, Menu entretient selon moi avec le concept d’avant-garde un rapport d’identification et de mythification. Je ne suis pas certain que Caraco et Ory ont raison de le valider et de le reprendre à leur compte sans le questionner davantage.