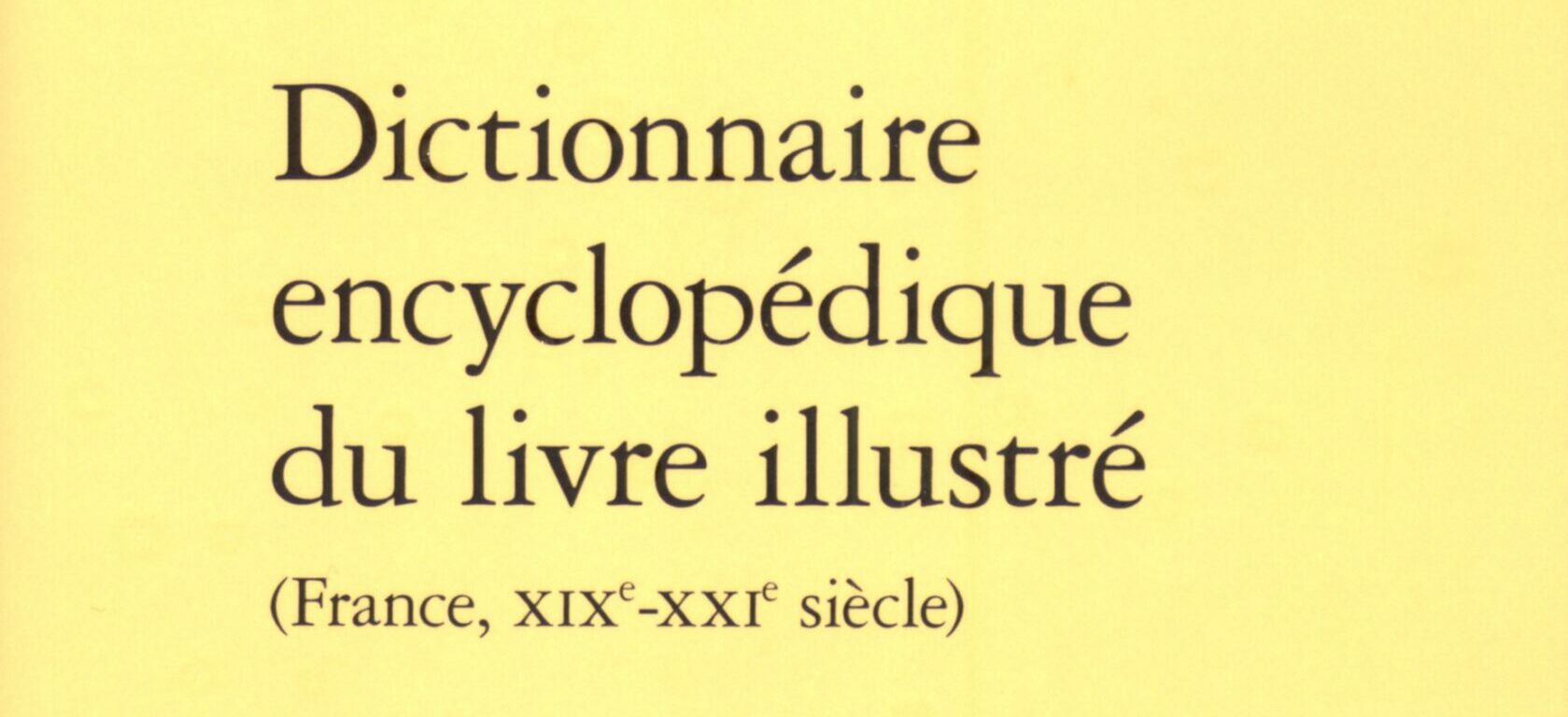Les éditions Classiques Garnier viennent de faire paraître une somme de plus de 800 pages, le Dictionnaire encyclopédique du livre illustré (France, XIXe-XXIe siècle), sous la direction de Philippe Kaenel et Hélène Védrine. Parmi les contributeurs figure Annie Renonciat, grande spécialiste du livre pour enfants, qui a notamment rédigé les articles « Album », « Epinal (images d’) » et « Jeunesse (images pour la »). Sa plume fait autorité et les amateurs de bande dessinée se souviendront qu’elle a notamment écrit naguère sur les « illustrés » d’Arthème Fayard (voir 9e Art n° 7) ou les paper dolls qui ont accompagné nombre de comic strips (en lien avec mon exposition Mode et bande dessinée). Kaenel est, quant à lui, l’auteur d’un essai qui a fait date sur Töpffer, Grandville et Doré.
Ceux qui s’intéressent aux approches sémiotiques pourront se reporter aux articles de Bernard Vouilloux « Intermédialité », « Sémiotique » et « Texte et image ». Mais je me bornerai ici à faire quelques observations sur les articles « Bande dessinée » et « Roman graphique », tous deux écrits par Jan Baetens.

Le premier point qui mérite d’être interrogé concerne précisément l’existence de deux articles, là où un seul aurait peut-être suffi, si l’on considère que ce que l’on désigne comme roman graphique n’est, après tout, que l’un des formes de la bande dessinée. Baetens ne manque pas de souligner que l’appellation est controversée : « beaucoup d’auteurs, et non des moindres comme Spiegelman et Satrapi, rejettent énergiquement le terme », écrit-il. Mais, en lui dédiant un article séparé, le fait est qu’il l’avalise et l’essentialise. Dès lors, on s’attend à se voir proposer une définition claire, fondée sur des critères, des « propriétés internes », qui permettraient de discriminer roman graphique et bande dessinée. Malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas. L’auteur retient principalement le format, « plus proche de celui du roman », « plus maniable » qu’un album standard, les thèmes « souvent autobiographiques mais aussi, depuis peu, journalistiques ou non-fictionnels », et le droit de dessiner « moche » (!). Pour conclure (p. 669) : « ces diverses transformations permettent de définir le roman graphique comme une forme de bande dessinée d’auteur, pour reprendre une comparaison cinématographique ». (Je me permettrai de rappeler que j’ai introduit le concept de bande dessinée d’auteur dès 1985 dans mon petit livre La Bande dessinée depuis 1975, et que je crois avoir été le premier à le faire.)
Or, si le format et la dimension autobiographique conviennent à Spiegelman et Satrapi (je fais évidemment référence à Maus et à Persepolis), ils ne s’appliquent aucunement aux « romans (À Suivre) » tel que Ici Même, de Tardi et Forest, dans lequel Baetens voit, à juste titre, un jalon essentiel. En outre, les bandes dessinées « journalistiques ou non fictionnelles » coïncident de moins en moins avec le format roman : il suffit ici de citer deux très gros succès de librairie, Le Monde sans fin, de Blain et Jancovici, et Histoire de Jérusalem, de Lemire et Gaultier, qui sont tous deux des albums grand format, cartonnés et en couleur.
Bref, Jan Baetens se débat dans des contradictions insolubles, et comment lui en voudrais-je, moi qui ai écrit dans le Bouquin de la bande dessinée (article « Roman graphique » curieusement non cité dans sa bibliographie) que cette catégorie reste décidément et ontologiquement entachée d’un flou considérable.
En vérité, le grand format cartonné couleur à forte pagination est le standard qui tend à s’imposer depuis quelques années, marginalisant le format « roman », même chez un éditeur alternatif comme le Frémok (dont Baetens est proche), et qu’il s’agisse de fiction ou de non-fiction.
Une définition simple, correspondant aux usages actuels, à laquelle je me rallierais volontiers est celle que donne Martin Veyron dans l’entretien qu’il a accordé aux Cahiers de la bande dessinée (n° 28, p. 63) : « Le roman graphique est une longue BD qui peut s’affranchir du gaufrier. On peut jouer sur le rythme des cases, induisant une accélération quand on en met plein ou au contraire ralentir avec des pleines pages contemplatives ».
Dans l’article « Bande dessinée », j’ai relevé plusieurs points qui pourraient être discutés mais, pour ne pas être trop long, je n’en soulèverai ici qu’un seul. Baetens écrit : « … la migration des Aventures de Tintin d’un supplément pour enfants (dans les années 1930) à une publication plus généraliste s’adressant aux « jeunes de 7 à 77 ans » rend nécessaire la construction d’histoires susceptibles de plaire non seulement aux plus jeunes, comme à l’époque du Petit Vingtième, supplément gratuit pour la jeunesse du quotidien Le Vingtième Siècle, mais aussi aux parents, qui doivent assumer les frais d’abonnement au magazine. » Dans ce passage, chaque élément me paraît contestable. D’abord, il fait mine de prendre au pied de la lettre ce qui ne constituait qu’une formule publicitaire : je doute que l’hebdomadaire Tintin ait eu, dans les années 1950 et 1960, beaucoup de lecteurs de 77 ans, ou même de 40. Ensuite, la diffusion ne passait pas nécessairement par le système de l’abonnement. Moi-même, lecteur assidu de Tintin pendant toute ma jeunesse, j’allais l’acheter chaque semaine chez le marchand de journaux avec mon argent de poche et il n’a jamais été question que je m’y abonne, non plus qu’à aucun autre magazine. Enfin, on peut présumer que c’est au contraire le Petit Vingtième qui circulait plus largement au sein des familles et donc était susceptible d’être au moins parcouru par les parents, puisqu’il accompagnait un journal d’information destiné aux adultes.
J’ajouterai que le passage d’aventures feuilletonesques consistant en une simple accumulation de péripéties vers des intrigues plus charpentées s’accomplit, dans le cas d’Hergé, antérieurement à la création du journal Tintin. On peut la faire remonter aux années où Tintin fut prépublié dans Le Soir.