Longtemps les dessinateurs qui se mesuraient à des textes littéraires orientaient préférentiellement leurs choix vers des classiques : c’était René Giffey adaptant Vigny, Balzac ou Hugo, Dino Battaglia se confrontant à Poe, Rabelais et Maupassant, Hugo Pratt à Stevenson, Bernie Wrightson à Mary Shelley ou encore Alberto Breccia à Poe et Bram Stoker.
Tardi avait amorcé une transition vers un répertoire plus moderne en jetant son dévolu sur Léo Malet (encore en vie quand il s’appropria son Nestor Burma) et Jean-Patrick Manchette. Désormais, alors que les albums tirés de romans sont plus nombreux que jamais, on peut observer que la faveur des artistes va plutôt à des auteurs contemporains, de préférence ceux qui figurent en tête des ventes. « Les best-sellers de Guillaume Musso, Michel Bussi, Virginie Grimaldi ou encore Jean Teulé ont récemment séduit éditeurs et dessinateurs du neuvième art, proposant au public la nouvelle version d’une bonne histoire, et la catapultant souvent vers un nouveau succès éditorial », écrivait Élodie Carreira dans Livres hebdo le 14 novembre dernier. À ces noms, il convient d’ajouter notamment ceux de Pierre Lemaître, Virginie Despentes, Daniel Pennac, Yasmina Khadra, Sorj Chalandon et Arto Paassilinna – sans oublier Umberto Eco dont Milo Manara a transposé Le Nom de la rose, le résultat étant aussitôt qualifié par la presse de « BD phénomène ».
Certains écrivains ont choisi de s’adapter eux-mêmes (ainsi Bernard Werber, Guillaume Musso et Jean Rouaud), le plus souvent ils se contentent de donner leur autorisation et de se déclarer ravis du résultat. Élodie Carreira avait sûrement raison d’associer les éditeurs à ce mouvement de fond, car il est peu douteux que, réserve faite des authentiques coups de cœur éprouvés par tel ou tel dessinateur pour un livre particulier, ce sont eux, souvent, qui sont à l’origine de ces rencontres opportunistes entre littérature et bande dessinée. Mais le succès est-il nécessairement toujours au rendez-vous ? On se souvient de l’échec cuisant qu’avait connu Dupuis dans les années 1990 avec sa série d’albums – précocément interrompue – adaptés des livres de Paul-Loup Sulitzer.
Éditeur moi-même, j’ai publié relativement peu d’adaptations : Le Paradis perdu, de Pablo Auladell d’après Milton, Un héros de notre temps, de Céline Wagner d’après Lermontov, Ubu de Franciszka Themerson d’après Jarry, Faim, de Martin Ernstsen d’après Knut Hamsun, Gracchus le chasseur de Martoz d’après une nouvelle inachevée de Kafka, tandis que Jens Harder enluminait Gilgamesh et que David Prudhomme rajeunissait La Farce de maître Pathelin. Autant d’œuvres singulières, portées par une admiration sincère et travaillées dans une logique, non d’illustration, mais véritablement d’accaparement.
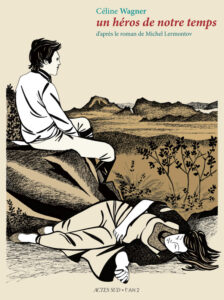
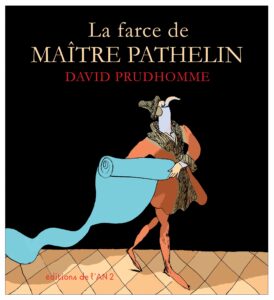
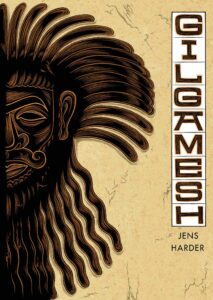
On le voit, il s’est toujours agi de choix peu attendus et dans lesquels, à l’exception du dernier cité, je ne suis pas intervenu, me contentant d’accompagner les dessinateurs et dessinatrices dans la réalisation de leur projet. En dépit de leurs hautes qualités, aucun de ces livres n’a connu le succès, ce qui pourrait donner à penser que la référence littéraire, quand elle ne concerne pas des auteurs de tête de gondole, est de nature à détourner ou intimider les lecteurs de bande dessinée, plutôt qu’à les attirer.


